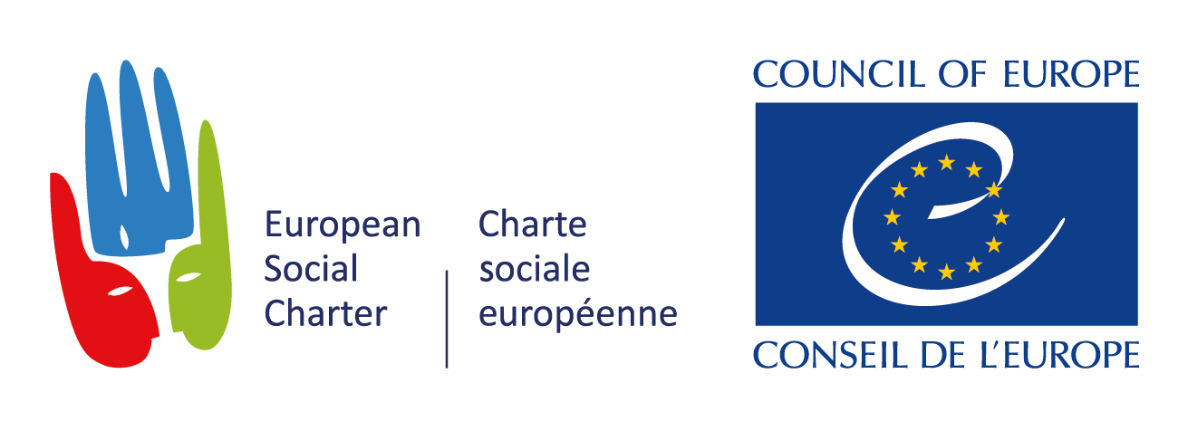Comment les O(I)NG peuvent-elles s’engager avec le Comité européen des Droits sociaux?
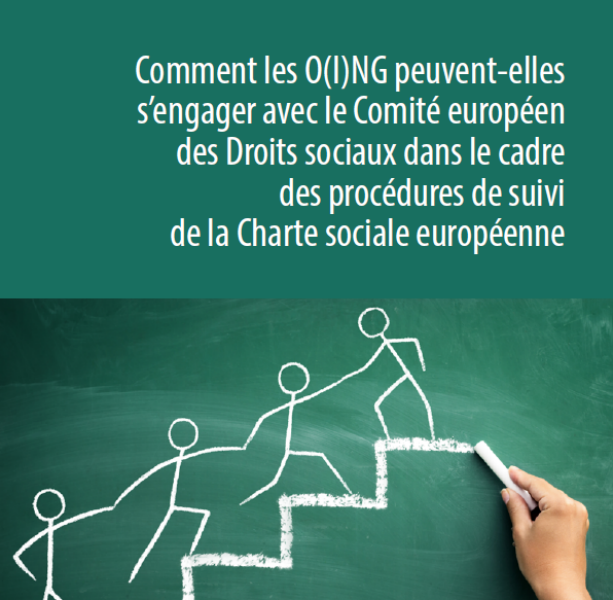
Qu’est-ce que la Charte sociale européenne ?
La Charte sociale européenne est un traité international qui protège les droits sociaux et économiques dans les États membres du Conseil de l'Europe, notamment les droits liés à l'emploi, à la sécurité au travail, à la santé, au logement, à l'éducation, à la protection sociale et à l'aide sociale. Elle exige que ces droits soient garantis sans discrimination et insiste particulièrement sur la protection des groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les migrants.
La Charte sociale européenne est considérée comme le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme, qui se concentre sur les droits civils et politiques. La Charte repose sur les mêmes principes d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance que les autres instruments relatifs aux droits de l'homme.
La plupart des États membres du Conseil de l'Europe (42 sur 46) ont exprimé leur consentement formel à se conformer à la Charte en "ratifiant" ce traité. Par l'acte de "ratification", les États deviennent "parties" à la Charte et, de ce fait, sont légalement tenus de respecter les droits consacrés par ce traité.
Deux traités
Deux versions de la Charte sociale européenne coexistent : la version initiale adoptée en 1961 et la version révisée adoptée en 1996. Cette dernière version intègre davantage de droits, tels que les droits des personnes âgées ou le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et met à jour plusieurs des droits déjà contenus dans la version initiale. La Charte révisée est destinée à remplacer progressivement la Charte de 1961. Les États peuvent être parties à l'une ou l'autre de ces versions, mais pas aux deux. La plupart des États (35 sur 42) ont maintenant ratifié la version révisée de la Charte sociale européenne. Lorsqu'un Etat ratifie la Charte révisée, il est lié, au minimum, par les dispositions qui correspondent à celles qu'il avait acceptées dans le cadre de la Charte de 1961.
Lorsqu'elles envisagent de s'engager dans les procédures de contrôle de la Charte sociale européenne, les ONG ((I)ONG) internationales et nationales devraient vérifier quelle version de la Charte sociale européenne a été "ratifiée" par l'Etat partie en question (la signature seule n'est pas suffisante). Cette information peut être trouvée dans le tableau des signatures et ratifications.
Un système à la carte
La Charte repose sur un système de ratification "à la carte". Cela permet aux États parties de choisir les dispositions qu'ils sont prêts à accepter en tant qu'obligations juridiques contraignantes : ils ne sont pas obligés d'accepter d'être liés par toutes les dispositions de la Charte sociale européenne. Toutefois, les États parties doivent s'engager à respecter un minimum de 10 articles ou 45 paragraphes numérotés en vertu de la Charte de 1961, et un minimum de 16 articles ou 63 paragraphes numérotés en vertu de la Charte révisée.
Lorsqu'elles envisagent de s'engager dans les procédures de suivi de la Charte sociale européenne, les (I)ONG doivent vérifier quelles dispositions de la Charte sociale européenne lient légalement l'Etat qui les intéresse, en vérifiant quelles dispositions ont été acceptées par l'Etat partie en question. Cette information peut être trouvée dans le tableau des dispositions acceptées.
Comment la mise en oeuvre de la Charte sociale européenne est-elle contrôlée ?
La mise en œuvre de la Charte sociale européenne par les États parties est supervisée par le Comité européen des droits sociaux. Le Comité européen des droits sociaux est un organe composé de 15 experts indépendants élus par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ses 15 membres sont élus pour une période de six ans, renouvelable une fois.
Le Comité européen des droits sociaux surveille et encourage la mise en œuvre de la Charte sociale européenne par les États parties au moyen de procédures complémentaires :
La procédure de réclamation collective ;
La procédure de rapport sur les dispositions acceptées ;
La procédure de rapport ad hoc ;
(Les ONG peuvent s'engager et contribuer de manière significative à ces quatre procédures.
Le Comité européen des droits sociaux adopte des "conclusions" sur les rapports nationaux soumis par les États parties et des "décisions" sur les réclamations collectives déposées par les organisations habilitées. L'interprétation donnée par le Comité européen des droits sociaux à chacune des dispositions de la Charte sociale européenne se trouve dans le Digeste de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux. Il s'agit d'un document important, car il clarifie le contenu des droits consacrés par la Charte et ce que l'on attend des États qui ont accepté d'être liés par ces droits, en se référant aux décisions et conclusions pertinentes du Comité européen des droits sociaux.
Étant donné que les décisions et les conclusions se réfèrent à des dispositions juridiques contraignantes et qu'elles sont adoptées par un organe de contrôle établi par la Charte et les protocoles pertinents, elles doivent être respectées par l'État concerné. Même si les décisions et les conclusions ne sont pas directement applicables dans les systèmes juridiques nationaux, elles établissent le droit et peuvent servir de base à une évolution positive des droits sociaux par le biais de la législation et de la jurisprudence au niveau national.
En outre, le Comité européen des droits sociaux rédige des rapports, en réponse aux rapports des États parties sur les dispositions non acceptées ou à leurs rapports ad hoc (voir ci-dessous).
De plus amples informations sur le Comité européen des droits sociaux sont disponibles dans son règlement et sur la page correspondante du site web de la Charte sociale européenne.
Qu’est-ce que la procédure de réclamations collectives ?
La procédure de réclamations collectives a été introduite par le protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives adopté en 1995.
La procédure de réclamations collectives vise à améliorer l'application des droits sociaux garantis par la Charte et à renforcer la participation des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. Elle vise à atteindre ces objectifs en permettant à des organisations particulières de déposer des réclamations contre des États parties à la Charte sociale européenne qui - prétendument - n'appliquent pas ce traité de manière adéquate.
Il convient de noter que les Etats parties à la Charte sociale européenne ne sont pas obligés de ratifier le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, bien qu'ils soient fortement encouragés à le faire. Par conséquent, il est recommandé aux (I)ONG de vérifier si l'Etat qui les intéresse a "ratifié" le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives (la signature seule est insuffisante), ou alternativement, a accepté d'être lié par la procédure de réclamations collectives en faisant la déclaration prévue par l'article D (2) de la Charte révisée (la Bulgarie, la Slovénie et l'Espagne ont fait cette déclaration). Ce n'est qu'à ce moment-là que des réclamations collectives peuvent être introduites contre l'État. Pour des informations actualisées, veuillez consulter le tableau des signatures et ratifications du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. À l'heure actuelle, 16 États parties à la Charte ont accepté d'être liés par la procédure et peuvent donc faire l'objet d'une réclamation.
Quelles sont les organisations habilitées à déposer des réclamations collectives auprès du Comité européen des Droits sociaux ?
Conformément à l'article 1 du protocole additionnel, des organisations spécifiques sont autorisées à déposer une réclamation auprès du Comité européen des droits sociaux si elles estiment qu'un État partie à la Charte sociale européenne (et au protocole additionnel) n'a pas correctement mis en œuvre la Charte. Ces organisations sont les suivantes :
Certaines organisations internationales d'employeurs et de syndicats, à savoir la Confédération européenne des syndicats (CES), pour les salariés, ainsi que Business Europe et l'Organisation internationale des employeurs (OIE), pour les employeurs.
Les organisations internationales non gouvernementales dotées du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe et inscrites sur une liste à cet effet (Liste des OING habilitées à présenter des réclamations collectives). De plus amples informations sur la demande, le renouvellement ou les conditions d'habilitation des OING à présenter des réclamations au Comité européen des droits sociaux sont également disponibles sur le site Internet du Conseil de l'Europe.
Les organisations nationales représentatives des employeurs et des syndicats relevant de la juridiction de l'État partie contre lequel ils ont déposé une réclamation.
En outre, tout État peut accorder aux ONG nationales représentatives relevant de sa juridiction le droit d'introduire des réclamations à son encontre (en faisant une "déclaration" en vertu du Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives ou en vertu de l'article D§2 de la Charte révisée, selon le cas). Jusqu'à présent, seule la Finlande l'a fait.
Comment les O(I)NG peuvent-elles déposer des réclamations collectives auprès du Comité européen des Droits sociaux ?
Pour être déclarée recevable, une réclamation collective doit remplir plusieurs critères. Ces critères sont énoncés dans le Protocole additionnel lui-même et dans le Règlement du Comité européen des droits sociaux ; ils ont été interprétés plus en détail dans des décisions individuelles sur la recevabilité.
- La réclamation doit être déposée par écrit.
- La réclamation doit être adressée au Secrétaire exécutif du Comité européen des droits sociaux agissant au nom du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
- La réclamation doit être envoyée , de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]
Adresse postale: Service des droits sociaux; Direction générale des droits de l'homme et de l'État de droit, Conseil de l'Europe ; 1, quai Jacoutot,
F-67075 Strasbourg Cedex, France
- La réclamation doit indiquer clairement le nom et les coordonnées de l'organisation réclamante.
- La réclamation doit être signée par une personne habilitée à représenter l'organisation réclamanteet doit démontrer que la personne qui dépose et signe la réclamation est habilitée à représenter l'organisation.
- La réclamation doit démontrer que l'organisation qui dépose la réclamation est habilitée à le faire, au sens de la procédure de réclamations collectives (voir la sous-section "Quelles sont les organisations habilitées à déposer des réclamations collectives auprès du Comité européen des droits sociaux", ci-dessus).
- Si la réclamation est déposée par des instances internationales, elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe (anglais ou français).
- Si la réclamation est déposée par des organisations nationales, elle doit être rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État partie concerné.
- La réclamation doit concerner un État partie à la Charte sociale européenne qui a accepté d'être lié par la procédure de réclamation collective (voir les sous-sections "Deux traités" et "Qu'est-ce que la procédure de réclamations collectives ?)
- La réclamation doit porter sur une ou plusieurs dispositions de la Charte, acceptées par l'État partie concerné (voir la sous-section "Un système sur mesure", ci-dessus).
- La réclamation doit indiquer en quoi l'État partie concerné n'a pas veillé à l'application satisfaisante de cette disposition (avec des preuves, des arguments pertinents et des documents à l'appui).
- La réclamation doit soulever des questions concernant la non-conformité du droit ou des pratiques d'un État avec une ou plusieurs dispositions de la Charte ; les réclamations portant sur des situations individuelles ne peuvent pas être présentées.
Comment la procédure de réclamations collectives fonctionne-t-elle ?
Recevabilité
Le Comité européen des droits sociaux examinera tous les points énumérés ci-dessus (voir la section "Comment les O(I)NG peuvent-elles déposer des réclamations collectives auprès du Comité européen des droits sociaux") et rendra une décision sur la recevabilité de la réclamation.
Procédure
Si le Comité européen des droits sociaux déclare la réclamation recevable, il invitera l'État concerné à présenter des observations écrites sur le bien-fondé de la réclamation et il invitera l'organisation qui a déposé la réclamation à répondre à ces observations. Une audition publique peut être organisée par la suite, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du Comité européen des droits sociaux.
Bien-fondé de la réclamation
Le Comité européen des droits sociaux examinera tous les arguments et les preuves présentés au cours de la procédure et rendra une décision sur le bien-fondé de la réclamation. Cette décision établit si la législation et/ou la pratique de l'État concerné par la réclamation est conforme à la Charte sociale européenne.
Mise en oeuvre
La décision du Comité européen des droits sociaux doit être mise en œuvre par l'État concerné. Cependant, la décision n'est pas directement exécutoire par les tribunaux de l'Etat concerné. La mise en œuvre de la décision est supervisée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui peut adopter une résolution ou adresser une recommandation à l'État concerné. En tout état de cause, le Comité des Ministres ne peut pas revenir sur l'appréciation juridique faite par le Comité européen des droits sociaux.
Rapport de suivi
Si le Comité européen des droits sociaux constate une violation de la Charte sociale européenne dans sa décision sur le bien-fondé de la réclamation, l'Etat concerné doit fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette décision. Dans ce cas, l'Etat concerné doit soumettre un rapport de suivi (un rapport par décision dans laquelle des violations ont été constatées) deux ans après que le Comité des Ministres a adopté une recommandation concernant la décision en question. Le Comité européen des droits sociaux examinera le rapport de suivi pour déterminer si l'Etat concerné a mis la situation en conformité avec la Charte sociale européenne et publiera ses "constats" à cet égard. Ces constats seront transmis au Comité des Ministres et, en fonction de l'évaluation du Comité européen des droits sociaux, le Comité des Ministres pourra alors clore l'affaire par une résolution ou adopter une (deuxième) recommandation.
Mesures immédiates
Le Comité européen des droits sociaux peut exiger que l'Etat concerné prenne des mesures immédiates pour éviter le risque d'un préjudice grave et irréparable, en relation avec les droits reconnus dans la Charte sociale européenne (article 36). Cette demande peut être faite à tout moment de la procédure . Elle peut être faite à l'initiative du Comité européen des droits sociaux ou à la demande de l'organisation réclamante.
Si l'organisation réclamante demande des mesures immédiates, elle doit préciser : les raisons pour lesquelles des mesures immédiates sont demandées ; les conséquences possibles si elles ne sont pas accordées ; et les mesures particulières demandées. Conformément à l'article 36§3 du règlement, le Comité fixe un délai pour que l'État défendeur fournisse des informations complètes sur la mise en œuvre des mesures immédiates demandées.
Comment les organisations formulent-elles des observations sur les procédures de réclamations introduites par des tiers ?
Conformément aux articles 32 et 32A du Règlement du Comité européen des droits sociaux, il est possible pour des tiers d'intervenir dans la procédure relative à une réclamation collective dans laquelle ils ne sont pas directement impliqués.
En vertu de l'article 32, le Comité européen des droits sociaux invitera les organisations internationales d'employeurs et de syndicats à présenter des observations en tant que tierces parties, sur des réclamations déposées par des organisations nationales d'employeurs et de syndicats ou déposées par des organisations non gouvernementales. Cette invitation concerne : la Confédération européenne des syndicats (CES), pour les travailleurs ; ainsi que Business Europe et l'Organisation internationale des employeurs (OIE), pour les employeurs. Leurs observations seront transmises à l'Etat défendeur et à l'organisation qui a déposé la réclamation.
Le Comité européen des droits sociaux peut également inviter les États qui ont accepté d'être liés par la procédure de réclamations collectives, mais
qui ne sont pas concernés par la réclamation, à formuler des observations en tant que tierces parties.
En outre, en vertu de l'article 32A, le Comité européen des droits sociaux peut inviter toute organisation, institution ou personne qu'il juge appropriée à présenter des observations en tant que tiers (y compris les (I)ONG et les syndicats). Les observations des tiers doivent être présentées dans le déla prescrit par le Comité (en général, deux mois maximum). Elles doivent être claires, concises et traiter du problème spécifique en question en s'appuyant sur la plainte et les arguments avancés, et éviter d'élargir la portée de la plainte. Les observations des tiers seront ensuite transmises à l'État défendeur et à l'organisation qui a déposé la réclamation. En outre, les organisations de la société civile peuvent également faire part au Comité européen des droits sociaux de leur intérêt à soumettre des observations en tant que tierces parties sur une réclamation collective en cours. Pour ce faire, elles sont invitées à contacter le Secrétariat de la Charte sociale européenne.
Où trouver des informations sur les réclamations collectives antérieures ?
La jurisprudence du Comité européen des droits sociaux peut être consultée dans la base de données HUDOC relative à la Charte sociale européenne.
HUDOC permet au lecteur d'affiner sa recherche en sélectionnant des types particuliers de documents en rapport avec les réclamations collectives, en fonction de son intérêt (décisions sur la recevabilité, décisions sur le bien-fondé, demandes de mesures immédiates, décisions de radiation d'une réclamation, opinions séparées ou suivi de décisions). HUDOC permet également aux lecteurs d'affiner leur recherche en sélectionnant des paramètres particuliers impliqués dans des réclamations collectives antérieures, en fonction de leur intérêt (dispositions particulières de la Charte sociale européenne, États ou organisations réclamantes impliqués dans des décisions antérieures).
En outre, le site web de la Charte sociale européenne fournit des informations sur toutes les réclamations en cours et traitées. Ces informations comprennent tous les documents échangés au cours de la procédure de réclamation collective, pour chaque réclamation (c'est-à-dire les réclamations déposées, les observations, les soumissions et les réponses des parties et des tiers, ainsi que la décision adoptée par le Comité européen des droits sociaux).
De plus amples informations sur la procédure de réclamations collectives sont disponibles dans le Règlement du Comité européen des droits sociaux (voir Partie VIII, Règles 23-40), ou sur la page correspondante du site Internet du Conseil de l'Europe.
Des informations complémentaires sur la procédure de réclamations collectives peuvent être consultées dans le Règlement du Comité européen des Droits sociaux (voir Partie VIII, articles 23-40) et sur la page dédiée du site internet du Conseil de l’Europe.
La procédure de rapports sur les dispositions acceptées
Le système de rapport a été introduit par la version initiale de la Charte sociale européenne adopté en 1961 (voir partie IV), et a été amendé par le Protocole de Turin adopté en 1991. Bien que le protocole de Turin ne soit pas entré en vigueur, il est appliqué sur la base d'une décision unanime prise en 1991 par le Comité des ministres.
Le système de rapports vise à améliorer la réalisation des droits sociaux garantis par la Charte sociale européenne et à faciliter un dialogue régulier et renforcé avec les États parties, les organisations de la société civile, les institutions nationales des droits de l'homme et les organismes nationaux de promotion de l'égalité. Elle vise à atteindre ces objectifs en invitant les États à soumettre des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne et en permettant à certaines organisations, y compris les (I)ONG et les syndicats, de soumettre des commentaires et des informations supplémentaires.
Tous les États parties à l'une ou l'autre version de la Charte sociale européenne doivent soumettre des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne. Cependant, les droits sur lesquels les États doivent faire rapport dépendent de la version de la Charte sociale européenne qu'ils ont ratifiée (voir la sous-section "Deux traités" ci-dessus) et des dispositions qu'ils ont acceptées (voir la sous-section Un système à la carte", ci-dessus). Par conséquent, il est recommandé aux (I)ONG de vérifier ces informations.
De plus amples informations sur la procédure de rapport peuvent être trouvées dans le Règlement du Comité européen des droits sociaux (voir Partie VII, Articles 19-22).
Quelles sont les organisations qui peuvent soumettre des informations supplémentaires en plus des rapports nationaux ?
Conformément aux articles 23 (1) et 27 (2) de la Charte sociale européenne telle qu'amendée par le Protocole de Turin, certaines organisations internationales d'employeurs et de syndicats sont habilitées à soumettre des commentaires et des informations en même temps que les rapports nationaux au Comité européen des droits sociaux. Il s'agit notamment des membres affiliés nationaux de la Confédération européenne des syndicats (CES), pour les travailleurs, ainsi que des organisations nationales membres de Business Europe et de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), pour les employeurs.
Veuillez noter que les États parties à la Charte sociale européenne ont l'obligation de communiquer des copies de leurs rapports nationaux aux membres nationaux de ces organisations.
Conformément à la pratique de longue date du Comité européen des droits sociaux et à l'article 21A de son règlement, d'autres organisations, institutions et entités peuvent soumettre des commentaires sur les rapports nationaux. Ces organisations, institutions et entités sont les suivantes : les organisations non gouvernementales (internationales), ainsi que les organismes nationaux de défense des droits humains et les organismes nationaux de promotion de l'égalité.
Veuillez noter que la prise en compte de ces commentaires est laissée à l'entière discrétion du Comité européen des droits sociaux.
Comment les O(I)NG peuvent-elles présenter des informations complémentaires ?
Conformément à l'article 21A du Comité européen des droits sociaux, les commentaires sur les rapports nationaux doivent être soumis au Secrétariat de la Charte sociale européenne dans un délai fixé par le Comité (généralement au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle le Comité examine les rapports nationaux concernés). Ce délai a été fixé pour permettre aux Etats de répondre aux commentaires, s'ils le souhaitent.
Les organisations de la société civile peuvent soumettre des commentaires ou des informations complémentaires pour les rapports dus par les États qui n'ont pas accepté la procédure de réclamation collective et pour les rapports dus par les États qui ont accepté la procédure de réclamation collective.
Il n'y a pas de format particulier que les organisations de la société civile doivent respecter lorsqu'elles soumettent leurs commentaires sur les rapports nationaux au Comité européen des droits sociaux, dans le cadre de la procédure de rapport. Toutefois, le Comité accueille favorablement les rapports qui :
examiner le questionnaire soumis aux États parties au début du cycle de présentation des rapports ;
fournir des informations spécifiques et approfondies sur des questions négligées ou insuffisamment développées dans le rapport national ;
tient compte de l'examen antérieur et des conclusions du comité sur l'article en question ;
répondre aux questions posées par le Comité lors de l'examen précédent de la disposition en question.
Comment le système des rapports sur les dispositions acceptées fonctionne-t-il ?
Calendrier des rapports
Suite à une décision du Comité des Ministres de 2022, qui a adopté la réforme 2022 de la Charte sociale européenne, les dispositions de la Charte sociale européenne ont été divisées en deux groupes (et non plus quatre), aux finsdu système de rapports.
Les deux groupes sont les suivants :
Groupe 1 : Article 1 - Article 2 - Article 3 - Article 4 - Article 5 - Article 6 - Article 8 - Article 9 - Article 10 - Article 18 - Article 19 - Article 20 - Article 21 - Article 22 - Article 24 - Article 25 - Article 28 - Article 29.
Groupe 2 : Article 7 - Article 11 - Article 12 - Article 13 - Article 14 - Article 15 - Article 16 - Article 17 - Article 23 - Article 26 - Article 27 - Article 30 - Article 31.
Questions
Afin de mieux cibler la procédure et d'alléger la charge de travail des États, le Comité européen des droits sociaux et le Comité gouvernemental doivent préparer des "questions ciblées" à la suite de la réforme de la Charte sociale européenne de 2022. Ces questions sont transmises aux États parties au début de l'année au cours de laquelle les rapports doivent être présentés.
Présentation des rapports nationaux
Rapports dus par les États qui n'ont pas accepté la procédure de réclamations collectives
Depuis 2022, tous les États qui n'ont pas accepté la procédure de réclamations collectives doivent soumettre tous les deux ans un rapport sur les dispositions contenues dans l'un des deux groupes thématiques susmentionnés. Par conséquent, toutes les dispositions acceptées de la Charte doivent être examinées pour chaque État tous les quatre ans. Les rapports concernant cette catégorie doivent être soumis au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
Rapports dus par les États ayant accepté la procédure de réclamations collectives
Depuis 2022, tous les États qui ont accepté la procédure de réclamations collectives doivent soumettre tous les quatre ans un rapport sur les dispositions contenues dans l'un des deux groupes thématiques susmentionnés. Par conséquent, toutes les dispositions acceptées de la Charte doivent être examinées pour chaque État tous les huit ans. Les rapports concernant cette catégorie doivent être soumis au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
Réunions
Le Comité européen des droits sociaux peut décider d'organiser des réunions avec des représentants d'un État, de sa propre initiative ou à la demande de l'État concerné, pour discuter des détails du rapport national. Les organisations internationales d'employeurs et les organisations syndicales internationales autorisées à présenter des observations en marge des rapports nationaux seront, dans certains cas, invitées à participer à ces réunions et pourront en informer leurs organisations nationales membres. Les organisations nationales d'employeurs, les syndicats nationaux ainsi que les institutions nationales des droits de l'homme, les organismes nationaux de promotion de l'égalité et les (I)ONG peuvent également être invités à participer à ces réunions si l'État concerné y consent (Règle 21) .
Conclusions
Le Comité européen des droits sociaux examinera tous les rapports et commentaires reçus au cours de la procédure, ainsi que toute information reçue en réunion. Il adoptera ensuite des conclusions concernant la mise en œuvre de la Charte sociale européenne par chacun des États concernés. Ces dernières années, le Comité européen des droits sociaux a adopté ses conclusions en janvier et celles-ci ont été publiées en mars.
Suivi
Les conclusions du Comité européen des droits sociaux doivent être respectées par l'État concerné. Toutefois, les conclusions ne sont pas directement applicables par les tribunaux de l'État concerné. La mise en œuvre des conclusions est supervisée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe par le biais de la procédure de suivi (voir ci-dessous).
Si le Comité européen des droits sociaux constate une violation de la Charte sociale européenne dans ses conclusions, l'État concerné doit fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à ces conclusions lors de la présentation de son prochain rapport national. Le suivi des conclusions est assuré par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, à la suite des propositions faites par le Comité gouvernemental (qui comprend des représentants des États parties à la Charte et des observateurs représentant les organisations syndicales et patronales européennes).
A la fin de chaque cycle de supervision, le Comité des Ministres adoptera une résolution basée sur les propositions faites par le Comité gouvernemental, contenant des orientations individuelles pour l'Etat partie concerné. Si l'Etat partie concerné n'a pas pris de mesures, le Comité des Ministres émettra alors une recommandation, basée sur les propositions du Comité gouvernemental, demandant à l'Etat de modifier la situation en droit et/ou en pratique. Suite à la réforme de la Charte sociale européenne de 2022, l'accent est davantage mis sur les recommandations, qui peuvent inclure des réunions techniques appropriées, des échanges de bonnes pratiques et des projets de coopération.
De plus amples informations sur la procédure de rapport et sur le suivi des conclusions sont disponibles sur le site web du Conseil de l'Europe.
Où trouver des documents concernant les rapports précédents ?
La jurisprudence du Comité européen des droits sociaux peut être consultée dans la base de données HUDOC relative à la Charte sociale européenne.
HUDOC permet aux lecteurs d'affiner leur recherche en sélectionnant des types particuliers de documents en rapport avec la procédure de rapport, en fonction de ce qui les intéresse (conclusions, déclarations d'interprétation, avis séparés ou suivi des conclusions). HUDOC permet également aux lecteurs d'affiner leur recherche en sélectionnant des paramètres particuliers impliqués dans les cycles de rapports précédents, en fonction de ce qui les intéresse (dispositions particulières de la Charte sociale européenne, États ou constatations de (non)conformité impliquées dans les cycles de rapports précédents).
Les rapports nationaux précédents et les soumissions (y compris celles des (I)ONG et des syndicats) peuvent être consultés sur la page web des profils nationaux de la Charte sociale européenne.
Des informations complémentaires sur le système de rapports peuvent être obtenues dans le Règlement du Comité européen des Droits sociaux (voir Partie VII, articles 19-22) ou sur la page dédiée du site internet du Conseil de l’Europe.
Qu'est-ce que la procédure de rapport ad hoc ?
Suite à une décision prise en 2022 par le Comité des ministres, qui a été le fer de lance de la réforme de la Charte sociale européenne en 2022, les États parties peuvent être invités à soumettre des rapports ad hoc pour analyse ou examen par le Comité européen des droits sociaux. Ces rapports peuvent être demandés lorsque des questions nouvelles ou critiques se posent avec une portée large ou transversale ou avec une dimension paneuropéenne.
Conformément à cette décision, le Comité européen des droits sociaux et le Comité gouvernemental ont décidé, en 2023, de demander un rapport ad hoc sur la crise du coût de la vie à tous les États parties à la Charte sociale européenne.
Le sujet et le calendrier des rapports ad hoc sont décidés par le Comité européen des droits sociaux et le Comité gouvernemental.
Comment fonctionne la procédure de rapport ad hoc ?
Comme indiqué dans une décision du Comité des Ministres datant de 2022, le Comité européen des droits sociaux est invité à examiner les informations fournies par les Etats concernés, à la suite de quoi il peut fournir une vue d'ensemble de la situation et une analyse juridique générale du point de vue de la Charte (de tels commentaires peuvent inclure des déclarations d'interprétation). Toutefois, le Comité européen des droits sociaux ne peut pas émettre de conclusions sur la conformité de la situation avec la Charte, dans le cadre de la procédure de rapport ad hoc.
Conformément à l'article 21A du règlement du Comité européen des droits sociaux, d'autres organisations, institutions et entités peuvent soumettre des commentaires sur les rapports ad hoc des États : les organisations syndicales et patronales, les (I)ONG, les institutions nationales des droits de l'homme et les organismes nationaux de promotion de l'égalité. Veuillez noter que la prise en compte de ces commentaires et la manière dont ils sont pris en compte sont laissées à l'entière discrétion du Comité européen des droits sociaux.
Le suivi devrait impliquer un dialogue avec les Etats parties et associer les organisations de la société civile concernées ainsi que les institutions nationales des droits de l'homme et les organismes nationaux de promotion de l'égalité, afin d'identifier les actions qui pourraient être nécessaires pour assurer le respect des obligations découlant de la Charte. En outre, le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne peut proposer que des orientations supplémentaires ou des recommandations générales soient adressées à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
Où trouver la documentation liée aux procédures d'établissement de rapports ad hoc ?
Les rapports ad hoc soumis par les États parties peuvent être consultés sur la page web des profils nationaux de la Charte sociale européenne, en cliquant sur le profil de l'État concerné.
Quelle est la procédure de notification des dispositions non acceptées ?
La procédure de rapport sur les dispositions non acceptées vise à encourager les États parties à accepter progressivement toutes les dispositions de la Charte.
Conformément à l'article 22 de la Charte de 1961, le Comité des Ministres peut demander aux Etats d'envoyer, à des intervalles appropriés, des rapports relatifs aux dispositions de la Charte qu'ils n'ont pas acceptées au moment de leur ratification ou de leur approbation ou lors d'une notification ultérieure. La mise en œuvre de cette disposition est devenue effective après une décision du Comité des Ministres en 2002, suite à laquelle les Etats ayant ratifié la Charte sociale européenne révisée doivent faire rapport sur les dispositions non acceptées tous les cinq ans à compter de la date de ratification.
En septembre 2022, le Comité européen des droits sociaux a adopté une décision visant à mettre en œuvre la procédure relative aux dispositions non acceptées de manière renforcée, pour tous les États parties à l'une ou l'autre des chartes (version 1961 ou version 1996).
Comment fonctionne la procédure de notification des dispositions non acceptées ?
Fonctionnement
Les Etats parties doivent soumettre des informations écrites selon un calendrier préétabli (voir annexe 2 du présent rapport). Le Comité européen des droits sociaux examinera ensuite ces informations et organisera des réunions bilatérales avec l'Etat concerné lorsqu'il estime qu'elles représentent une valeur ajoutée à la procédure. Le Comité européen des droits sociaux rédigera ensuite un rapport pour chaque Etat contenant ses évaluations non contraignantes des situations nationales, sur la base des informations dont il dispose (soit la soumission d'informations écrites par l'Etat, soit les informations obtenues dans le cadre des réunions).
En vertu de l'article 21A du Règlement du Comité européen des droits sociaux, les organisations de la société civile (y compris les (I)ONG et les syndicats), ainsi que les institutions nationales des droits de l'homme et les organismes nationaux de promotion de l'égalité, peuvent soumettre des commentaires sur les informations écrites fournies par les Etats au plus tard trois mois après que ledit document a été mis à disposition sur le site Internet du Conseil de l'Europe. En outre, le cas échéant et à l'initiative du Comité européen des droits sociaux ou des États parties, des réunions bilatérales peuvent être organisées avec les États concernés et avec la participation des partenaires sociaux nationaux et des représentants de la société civile.
Calendrier
Des informations écrites sur les dispositions non acceptées doivent être présentées tous les cinq ans, selon le calendrier figurant à l'annexe 2 de la publication. Les rapports doivent être soumis au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Où trouver la documentation relative aux rapports antérieurs sur les dispositions non acceptées ?
De plus amples informations sur la procédure de rapport sur les dispositions non acceptées, y compris les réunions et les rapports par pays, sont disponibles sur le la page dédiée.
Service des droits sociaux
Conseil de l'Europe
Direction générale des droits de l'Homme et de l'Etat de droit
1, quai Jacoutot
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 90 21 49 61
www.coe.int/socialcharter